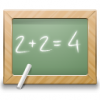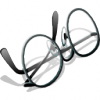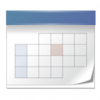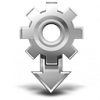La contractualité de la pratique ethnographique
Il y a un texte d'Abélès qui m'était jusqu'ici inconnu : « Le terrain et le sous-terrain » (2002)1. L'auteur y détaille une idée simple que je trouve tout à fait lumineuse, surtout au vu de mes récentes expériences de terrain. Il y souligne le caractère hautement négocié des enquêtes ethnographiques, c'est à dire de toute situation où un individu s'insère dans un monde qui n'est pas le sien en vue d'une entreprise de connaissance. La pratique de l'ethnographie ayant longtemps fonctionné sous le signe de l'évidence et de la spontanéité des interlocuteurs, représentants d'une altérité irréductible, il est bon de rappeler combien le rapport de l'ethnographe à son terrain procède de l'intrusion. Ce qui pose problème c'est la passivité supposée dans nombre de travaux anthropologiques de l'objet de recherche face à une présence “dominatrice” du chercheur.
Le caractère négocié de l'enquête ethnographique est particulièrement frappante si l'on s'intéresse aux centres de pouvoir proches, comme le Parlement européen ou l'Assemblée nationale, où la situation de domination se renverse au profit de l'objet de recherche. Dans de tels contextes, un premier contrat insitutionnel doit être entériné. Pour entrer « par la grande porte » le chercheur a en effet l'obligation d'obtenir une autorisation officielle, c'est-à-dire obtenir la validation – et donc l'adhésion – des instances décisionnelles de l'institution à son projet. Le badge, ce laissez-passez indispensable pour accéder aux personnes et aux lieux, qui est délivré à l'issue d'un processus de négociation, peut être considéré comme la représentation physique de ce pacte.
Ces formalités administratives accomplies, l'ethnographe est alors en mesure de se confronter aux individus et aux groupes qui l'intéressent. Or, les personnes que rencontre l'ethnographe ne sont pas significativement éloignées de lui en terme de formation et de position sociale. Il en résulte des situations singulières où par exemple, dans le cadre de premiers contacts, un individu va entreprendre de débattre sur l'œuvre de Bourdieu, manière d'évaluer le chercheur sur ses compétences et sa performance. Personne n'est dupe de l'enjeu : la demande de l'ethnographe est forte, l'ouverture au terrain est conditionnée par l'attitude de ces hôtes, ces derniers ayant bien souvent conscience du pouvoir qu'ils détiennent. L'attente – positive ou négative – à l'égard du chercheur ne peut pas en ce cas être sous-estimée, d'autant que cette proximité mutuelle pose implicitement le caractère “réappropriable” par l'observé du savoir que va produire l'anthropologue. Que l'interlocuteur accepte ou non de se soumettre au jeu de l'observation, il y aura bien eu une négociation autour de la question de l'accès au terrain et de ses modalités, même si elle est pour beaucoup constituée de non-dits.
En anthropologie, on a usage d'appeler terrain ce moment de l'enquête où l'on tente de s'immerger humainement dans son objet de recherche. Or, la relation en elle-même qui s'institue entre le chercheur et son objet, souvent escamotée dans le récit ethnographique, fait partie intégrante de ce terrain. C'est un ensemble de processus subtils qui conditionnent la quête d'information, qui ont un impact direct sur la problématisation ultérieure, et qu'il convient d'examiner donc dans une démarche réflexive. En tout état de cause, dans une métaphore qui présenterait ces mécanismes comme sous-jacents à l'entreprise ethnographique, Abélès conclue qu'il n'y a pas de terrain sans sous terrain.
Crédit illustration : « Surveying », George Washington , by Calista McCabe Courtenay, 1917.
- in C. Ghasarian (dir.), De l'ethnographie à l'anthropologie réflexive. Nouveaux terrains, nouvelles pratiques, nouveaux enjeux, Paris, Armand Colin