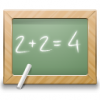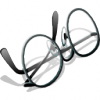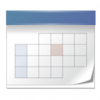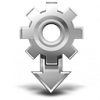Ne pas entrer à reculons dans la société et l'économie numériques
 « Il est possible de rémunérer les auteurs, de payer le juste prix et de ne pas payer ce qui est devenu gratuit. Et il est important de cesser d’entrer à reculons dans la société et l’économie numériques. »
« Il est possible de rémunérer les auteurs, de payer le juste prix et de ne pas payer ce qui est devenu gratuit. Et il est important de cesser d’entrer à reculons dans la société et l’économie numériques. »
Telle est la conclusion de Gratuité et prix de l’immatériel, le nouvel article de Jean-Pierre Archambault que nous vous proposons aujourd’hui. Il n’apporte fondamentalement rien de plus que ce que tout lecteur du Framablog connaissait déjà. Mais l’agencement des faits, la pertinence des exemples et l’enchaînement des arguments en font une excellente synthèse en direction du grand public. Á lire et à faire lire donc[1].
Je ne résiste d’ailleurs pas à vous recopier d’emblée cette petite fiction que l’on trouvera dans le paragraphe en faveur de la licence globale, histoire de vous mettre l’eau à la bouche : « Supposons que, dans le monde physique, ait été inventée une technologie miracle qui permette de remplacer immédiatement, à l’identique et sans aucun coût, tout CD retiré des bacs d’une surface de distribution. Dans un tel monde, il apparaîtrait impensable que des caisses soient disposées en sortie de magasin afin de faire payer les CD emportés par les clients : celui qui part avec 100 CD cause en effet exactement le même coût que celui qui part avec 10 CD ou encore que celui qui part avec 1 000 CD, c’est à dire zéro ! En revanche, personne ne comprendrait que des caisses ne soient pas installées à l’entrée, afin de facturer l’accès à une telle caverne d’Ali Baba. »
Gratuité et prix de l’immatériel
Jean-Pierre Archambault – CNDP et CRDP de Paris - Chargé de mission Veille technologique et coordonnateur du Pôle de compétences logiciels libres du SCÉREN - Médialog n°72 - Décembre 2009
Internet bouleverse les modalités de mise à disposition des biens culturels et de connaissance. Dans l’économie numérique, le coût de production d’une unité supplémentaire d’un bien (musique, film, logiciel…) étant, pour ainsi dire, nul, que doit-on payer ?
La réflexion sur les logiciels libres, biens communs mis à la disposition de tous, peut contribuer à éclairer la question des relations complexes entre gratuité, juste prix et légitime rémunération des auteurs.
Le thème de la gratuité est omniprésent dans nombre de débats de l’économie et de la société numériques, qu’il s’agisse de morceaux de musique, de films téléchargés, ou de logiciels qui, on le sait, se rangent en deux grandes catégories : libres et propriétaires. Les débats s’éclairent les uns les autres, car ils portent sur des produits immatériels dont les logiques de mise à disposition ont beaucoup de points communs.
Concernant les logiciels, « libre » ne signifie pas gratuit. La méprise peut venir de la double signification de free en anglais : libre, gratuit. À moins que son origine ne réside dans le fait qu’en pratique il y a toujours la possibilité de se procurer un logiciel libre sans bourse délier. Il peut s’agir également d’une forme d’hommage à la « vertu » des logiciels libres, et des standards ouverts. En effet, à l’inverse des standards propriétaires qui permettent de verrouiller un marché, ceux-ci jouent un rôle de premier plan dans la régulation de l’industrie informatique. Ils facilitent l’entrée de nouveaux arrivants, favorisent la diversité, le pluralisme et la concurrence. Ils s’opposent aux situations de rentes et de quasi monopole. De diverses façons, les logiciels libres contribuent à la baisse des coûts pour les utilisateurs. Par exemple, l’offre gratuite, faite en 2008 par Microsoft, sur sa suite bureautique en direction des enseignants, mais pas de leurs élèves, est une conséquence directe de la place du libre en général, d’OpenOffice.org en particulier, dans le paysage informatique. Et, c’est bien connu, les logiciels libres sont significativement moins chers que leurs homologues propriétaires.
Gratuit car payé
Il peut arriver que la gratuité brouille le débat. Elle n’est pas le problème. Les produits du travail humain ont un coût, le problème étant de savoir qui paye, quoi et comment. La production d’un logiciel, qu’il soit propriétaire ou libre, nécessite une activité humaine. Elle peut s’inscrire dans un cadre de loisir personnel ou associatif, écrire un programme étant un hobby comme il en existe tant. Elle n’appelle alors pas une rémunération, la motivation des hackers (développeurs de logiciels dans des communautés) pouvant résider dans la quête d’une reconnaissance par les pairs. En revanche, si la réalisation se place dans un contexte professionnel, elle est un travail qui, toute peine méritant salaire, signifie nécessairement rémunération. Le logiciel ainsi produit ne saurait être gratuit, car il lui correspond des coûts. Et l’on sait que dans l’économie des biens immatériels, contrairement à l’économie des biens matériels, les coûts fixes sont importants tandis que les coûts marginaux (coûts de production et diffusion d’un exemplaire supplémentaire) sont peu élevés. Dupliquer un cédérom de plus ou fabriquer un deuxième avion, ce n’est pas la même chose. Télécharger un fichier ne coûte rien (sauf l’accès au réseau).
Mais, même quand un logiciel n’est pas gratuit, il le devient lorsqu’il a été payé ! Enfin, quand il est sous licence libre. Qu’est-ce à dire ? Prenons le cas d’un client qui commande la réalisation d’un logiciel à une société et la lui paye intégralement, dans une relation de sous-traitance. Un travail a été fait et il est rémunéré. Si, en plus, le client a conservé ses droits de propriété sur le logiciel et décide de le mettre à disposition des autres sous une licence libre, le dit logiciel est alors librement et gratuitement accessible pour tout un chacun. Exit les licences par poste de travail. Bien commun, un logiciel libre est à la disposition de tous. À charge de revanche, mais c’est l’intérêt bien compris des uns et des autres de procéder ainsi, même s’il est vrai qu’il n’est pas toujours évident d’enclencher pareil cycle vertueux… Autre chose est de rémunérer des activités de service sur un logiciel devenu gratuit (installation, adaptation, évolution, maintenance…). Même si, ne versons pas dans l’angélisme, la tentation existe de ne pas développer telle ou telle fonctionnalité pour se ménager des activités de service ultérieures.
Il en va pour l’informatique comme pour les autres sciences. Les mathématiques sont libres depuis vingt-cinq siècles. Le temps où Pythagore interdisait à ses disciples de divulguer théorèmes et démonstrations est bien lointain ! Les mathématiques sont donc libres, ce qui n’empêche pas enseignants, chercheurs et ingénieurs d’en vivre.
Argent public et mutualisation
Le libre a commencé ses déploiements dans les logiciels d’infrastructure (réseaux, systèmes d’exploitation). Dans l’Éducation nationale, la quasi totalité des logiciels d’infrastructure des systèmes d’information de l’administration centrale et des rectorats sont libres. Il n’en va pas (encore…) de même pour les logiciels métiers (notamment les logiciels pédagogiques), mais cette situation prévaut en général, que ce soit dans les entreprises, les administrations, les collectivités locales ou dans des filières d’activité économique donnée.
Dans L’économie du logiciel libre[2], François Elie, président de l’Adullact (Association des Développeurs et des Utilisateurs de Logiciels Libres pour l’Administration et les Collectivités Territoriales), nous dit que l’argent public ne doit servir à payer qu’une fois ! Comment ne pas être d’accord avec pareille assertion ? En effet, si des collectivités territoriales ont un besoin commun, il n’y a aucune raison pour qu’elles fassent la même commande au même éditeur, chacune de son côté dans une démarche solitaire, et payent ce qui a déjà été payé par les autres. François Elie propose la mutualisation par la demande.
L’Éducation nationale est certes une « grande maison » riche de sa diversité, il n’empêche qu’il existe des besoins fondamentalement communs d’un établissement scolaire à l’autre, par exemple en matière d’ENT (espaces numériques de travail). Pourquoi des collectivités territoriales partiraient-elles en ordre (inutilement trop) dispersé ? Alors, qu’ensemble, elles peuvent acheter du développement partagé ou produire elles-mêmes. Et, dans tous les cas, piloter et maîtriser les évolutions. Ce qui suppose d’avoir en interne la compétence pour faire, ou pour comprendre et « surveiller » ce que l’on fait faire, aux plans technique et juridique. Dans le système éducatif, les enseignants ont la compétence métier, en la circonstance la compétence pédagogique, sur laquelle fonder une mutualisation de la demande, la production par les intéressés eux-mêmes se faisant dans des partenariats avec des éditeurs publics (le réseau SCÉREN) et privés. L’association Sésamath en est l’illustration majeure mais elle n’est pas seule : il y a aussi AbulEdu, Ofset, les CRDP…[3].
L’argent public ne doit servir qu’une fois, ce qui signifie une forme de gratuité selon des modalités diverses. C’est possible notamment dans l’équation « argent public + mutualisation = logiciels libres ». Le libre a fait la preuve de son efficacité et de ses qualités comme réponse à la question de la production de ce bien immatériel particulier qu’est le logiciel. Rien d’étonnant à cela. La production des logiciels restant une production de connaissances, contrairement à d’autres domaines industriels, elle relève du paradigme de la recherche scientifique. L’approche du logiciel libre, à la fois mode de réalisation et modalité de propriété intellectuelle, est transférable pour une part à d’autres biens, comme les ressources pédagogiques. Le logiciel libre est également « outil conceptuel » pour entrer dans les problématiques de l’économie de l’immatériel et de la connaissance.
Gratuité et rémunération
Revenons sur les coûts fixes et marginaux dans l’économie à l’ère du numérique. L’économie de l’information s’est longtemps limitée à une économie de ses moyens de diffusion, c’est-à-dire à une économie des médias. Elle ne peut désormais plus se confondre avec l’économie du support puisque les biens informationnels ne sont plus liés rigidement à un support donné. L’essentiel des dépenses était constitué par les coûts de production, de reproduction matérielle et de distribution dans les divers circuits de vente. Aujourd’hui, les techniques de traitement de l’information, la numérisation et la mise en réseau des ordinateurs permettent de réduire les coûts de duplication et de diffusion jusqu’à les rendre à peu près nuls. Dans ces conditions, la valeur économique de l’information ne peut plus se construire à partir de l’économie des vecteurs physiques servant à sa distribution. De nouvelles sources de valeur sont en train d’apparaître. Le modèle économique de mise en valeur de l’information déplace son centre de gravité des vecteurs physiques vers des services annexes ou joints dont elle induit la consommation ou qui permettent sa consommation dans de bonnes conditions (services d’adaptation d’un logiciel au contexte d’une entreprise, de facilitation de l’accès à des ressources numérisées, commerce induit sur des produits dérivés, etc.).
Le copyright, qui défend principalement l’éditeur contre des confrères indélicats, aussi bien que le droit d’auteur, qui défend principalement l’auteur contre son éditeur, ont ceci en commun qu’ils créent des droits de propriété sur un bien abstrait, l’information[4]. Tant que cette information est rigidement liée à un vecteur physique, c’est-à-dire tant que les coûts de reproduction sont suffisamment élevés pour ne pas être accessibles aux particuliers, ces droits de propriété peuvent être imposés aisément. Mais le monde bouge…
Les débats sur la loi Création et Internet dite « loi Hadopi » ont tourné autour de la gratuité et de la rémunération des auteurs (et des éditeurs !). Face aux difficultés de recouvrement du droit d’auteur dans l’économie numérique, certains pensent manifestement que la solution réside dans le retour au modèle classique de l’information rigidement liée à son support physique, ce que certaines techniques de marquage pourraient permettre, annulant ainsi les bienfaits économiques de la numérisation et de la mise en réseau. Mais le rapide abandon des DRM (Digital Rights Management ou Gestion des Droits Numériques en français) qui se sont révélés inapplicables (après le vote en 2006 de la transposition en France de la directive européenne DADVSI[5] ) aurait tendance à démontrer le caractère illusoire de ce genre d’approche. Beaucoup pensent qu’un sort identique arrivera aux dispositions contenues dans la « loi Hadopi », que ces façons (anciennes) de poser les problèmes (nouveaux) mènent à une impasse. Pour, entre autres, les mêmes raisons de non faisabilité : le droit se doit d’être applicable. On sait, par ailleurs, que le Conseil constitutionnel a, dans un premier temps censuré le volet sanction de la « loi Hadopi », considérant que le droit de se connecter à Internet relève de la liberté de communication et d’expression et que ce droit implique la liberté d’accès à Internet (seule une juridiction peut être habilitée à le suspendre). Il a estimé que le texte conduisait à instituer une présomption de culpabilité.
Dans le cas d’un transfert de fichier, nous avons déjà signalé que le coût marginal est nul. Que paye-t-on ? Une part des coûts fixes. Mais il arrive un moment où la réalisation du premier exemplaire est (bien) amortie. D’où ces situations de rentes dans lesquelles on paye un fichier téléchargé comme s’il était gravé sur un support physique qu’il aurait fallu fabriquer et acheminer. De plus, l’économie générale des productions (les best sellers et les autres titres) d’un éditeur évolue avec Internet. Dans son ouvrage La longue traîne, Chris Anderson[6] théorise le principe de la longue traîne dans lequel la loi des 20/80 (20% des produits font 80% du chiffre d’affaires) disparaît avec Internet qui, en réduisant les coûts de fabrication et de distribution, permet à tous les produits qui ne sont pas des best-sellers (qui constituent des longues traînes) de rapporter parfois jusqu’à 98% du chiffre d’affaires.
Une licence globale
Il y a donc des questions de fond. Quel est le prix des biens culturels dématérialisés ? Quels doivent être leurs modes de commercialisation ? Alain Bazot, président de l’UFC-Que choisir, les pose[7]. Rappelant qu’un support physique a un coût et qu’il est « rival »[8], que l’on peut multiplier les fichiers numériques d’une oeuvre pour un coût égal à zéro, il en tire la conclusion que « la dématérialisation, parce qu’elle permet un partage sans coût de la culture, parce qu’elle constitue un accès à l’information et à l’art pour tous, remet fondamentalement en cause les modèles économiques existants. Dès lors, il apparaît essentiel de proposer de nouvelles formes de rémunération pour allier les avantages d’Internet à une juste rétribution des artistes/créateurs ». Et comme « dans une économie de coûts fixes, distribuer un ou 10 000 MP3 ne fait pas varier le coût de production », il est plus pertinent « de faire payer l’accès et non pas la quantité. Ce mode de commercialisation, apparu avec la commercialisation de l’accès à internet (le forfait illimité), est le modèle consacré par l’économie numérique ».
Et, pour illustrer le propos, Alain Bazot s’appuie sur une fiction fort pertinente de Nicolas Curien : « Supposons que, dans le monde physique, ait été inventée une technologie miracle qui permette de remplacer immédiatement, à l’identique et sans aucun coût, tout CD retiré des bacs d’une surface de distribution. Dans un tel monde, il apparaîtrait impensable que des caisses soient disposées en sortie de magasin afin de faire payer les CD emportés par les clients : celui qui part avec 100 CD cause en effet exactement le même coût que celui qui part avec 10 CD ou encore que celui qui part avec 1 000 CD, c’est à dire zéro ! En revanche, personne ne comprendrait que des caisses ne soient pas installées à l’entrée, afin de facturer l’accès à une telle caverne d’Ali Baba. »[9]
On retrouve donc la « licence globale », financée par tous les internautes ou sur la base du volontariat, mais également financée par les fournisseurs d’accès qui ont intérêt à avoir des contenus gratuits pour le développement de leurs services. En effet, comme le dit Olivier Bomsel[10], la gratuité est aussi un outil au service des entreprises, pour conquérir le plus rapidement possible une masse critique d’utilisateurs, les innovations numériques voyant leur utilité croître avec le nombre d’usagers, de par les effets de réseau.
Des créateurs ont déjà fait le choix du partage volontaire de leurs oeuvres numériques hors marché. Philippe Aigrain envisage une approche partielle (expérimentale dans un premier temps ?) dans laquelle les ayants droit qui « refuseraient l’inclusion de leurs oeuvres dans un dispositif de partage hors marché garderaient le droit d’en effectuer une gestion exclusive, y compris par des mesures techniques de protection ou par des dispositifs de marquage des oeuvres protégés contre le contournement ». Mais, « ils devraient cependant renoncer à imposer des dispositifs destinés à leurs modèles commerciaux dans l’ensemble de l’infrastructure des réseaux, appareils ou procédures et sanctions. »[11]
Enfin, s’il existe des modèles économiques diversifiés de l’immatériel, il ne faut pas oublier certains fondamentaux. C’est le reproche que Florent Latrive fait à Chris Anderson, « archétype du Californien hype », en référence à son livre paru récemment Free : « Dans son monde, les modèles économiques ne sont l’affaire que des seules entreprises. C’est un monde qui n’existe pas. Chris Anderson zappe largement le rôle de l’État et de la mutualisation fiscale dans sa démonstration. C’est pourtant fondamental : cela fait bien longtemps que l’importance sociale de certains biens, matériels ou immatériels, justifie l’impôt ou la redevance comme source de financement principale ou partielle. La santé gratuite en France n’implique pas le bénévolat des infirmières et des médecins. La gratuité de Radio France ne fait pas de ses journalistes des crève-la-faim »[12]. Effectivement, la santé et l’éducation représentent des coûts importants (des investissements en fait). La question posée n’est donc pas celle de leur gratuité mais celle de l’organisation de l’accès gratuit pour tous aux soins et à l’éducation. La réponse s’appelle sécurité sociale et école gratuite de la République financée par l’impôt.
Il est possible de rémunérer les auteurs, de payer le juste prix et de ne pas payer ce qui est devenu gratuit. Et il est important de cesser d’entrer à reculons dans la société et l’économie numériques.
Notes
[1] Crédit photo : Tibchris (Creative Commons By-Sa)
[2] François Elie, L’économie du logiciel libre, Eyrolles 2009.
[3] Voir J-P. Archambault, « Favoriser l’essor du libre à l’École » , Médialog n°66 et J-P Archambault, « Un spectre hante le monde de l’édition », Médialog n°63.
[4] Concernant la rémunération des auteurs, rappelons qu’elle ne représente en moyenne que 10% du prix d’un produit.
[5] Droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information
[6] Chris Anderson, La longue traîne, 2ème édition, Pearson 2009.
[7] Alain Bazot, « La licence globale : il est temps d’entrer dans l’ère numérique ! », billet posté sur le blog Pour le cinéma – La plateforme des artistes en lutte contre la loi Hadopi
[8] Un bien rival (ou bien privé pur) est un bien pour lequel une unité consommée par un agent réduit d’autant la quantité disponible pour les autres agents.
[9] Nicolas Curien, « Droits d’auteur et Internet : Pourquoi la licence globale n’est pas le diable ? », Janvier 2006.
[10] Olivier Bomsel, Gratuit ! Du développement de l’économie numérique, Folio actuel, 2007.
[11] Philippe Aigrain Internet & création, InLibroVeritas, 2008.